Le projet de loi ELAN (Évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique), a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le 12 juin 2018. Il est marqué par de petites avancées et par des reculs très importants de la politique publique de logement
Du 30 mai au 8 juin, les discussions en séance publique à l’Assemblée nationale ont notamment permis le renforcement de l’arsenal juridique en faveur de la lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil.
Toutefois, plusieurs associations travaillant sur la problématique du mal logements et l’accès au logement social, parmi lesquelles l’AFVS, dénoncent le recul du projet de loi ELAN sur plusieurs points :
-son retour en arrière sur l’encadrement des loyers
-sa création d’un « bail mobilité » meublé de courte durée de un à dix mois
-sa mise en place d’une procédure de vente de 40 000 logements sociaux par an,
-sa quasi-suppression des normes handicap
Pour en savoir plus, voir :
Le Haut Conseil de la Santé Publique vient de rendre publique la mise à jour de son guide pratique de dépistage et de prise en charge des expositions au plomb chez l’enfant mineur et la femme enceinte.
Dans sa version mise à jour, le guide décrit les facteurs de risques et les signes cliniques devant conduire à la prescription par un médecin d’une plombémie chez un enfant de moins de 6 ans ou chez une femme enceinte. De plus, les modalités de prise en charge des enfants et des femmes enceintes ayant bénéficié d’une plombémie sont décrites (conduite à tenir en fonction des concentrations sanguine de plomb, suivi des plombémies, traitement médicamenteux, suivi du développement psychomoteur et cognitif de l’enfant, mesures diététiques, conduite à tenir pour l’allaitement, etc.).
Ce guide est destiné aux professionnels de santé et acteurs du terrain et est présenté sous forme de 19 fiches pratiques indépendantes et complémentaires. Deux questionnaires pour l’identification des facteurs de risques environnementaux ou d’exposition destinés à la femme enceinte ou à l’enfant sont proposés.
Il est possible de télécharger le guide complet sur cette page du Haut Conseil Télécharger ici
Il est également possible de télécharger les différentes fiches de cette mise à jour ci-dessous.
Ce mercredi 4 avril 2018, le gouvernement français a présenté en Conseil des ministres son projet de loi logement, baptisé » ELAN » (Evolution du logement et aménagement numérique). Les réformes annoncées sont censées répondre à la crise du logement qui ne cesse de s’aggraver en France, où 4 millions de personnes sont mal logées ou privées de domicile. L’un des articles de ce projet de loi prévoit de renforcer la lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil. En France, près de 450 000 logements sont aujourd’hui considérés comme indignes, car ils présentent des risques pour la santé et la sécurité de leurs occupants. Particulièrement nombreux dans la région parisienne, loués à des prix usuriers par des propriétaires sans scrupules, ils accueillent des familles très modestes, souvent d’origine étrangère.
La radio RFI (Radio France International) a diffusé, ce même mercredi 4 avril, un reportage réalisé notamment à l’aide de l’AFVS.
A écouter ici Cliquer
Ou ci-dessous.
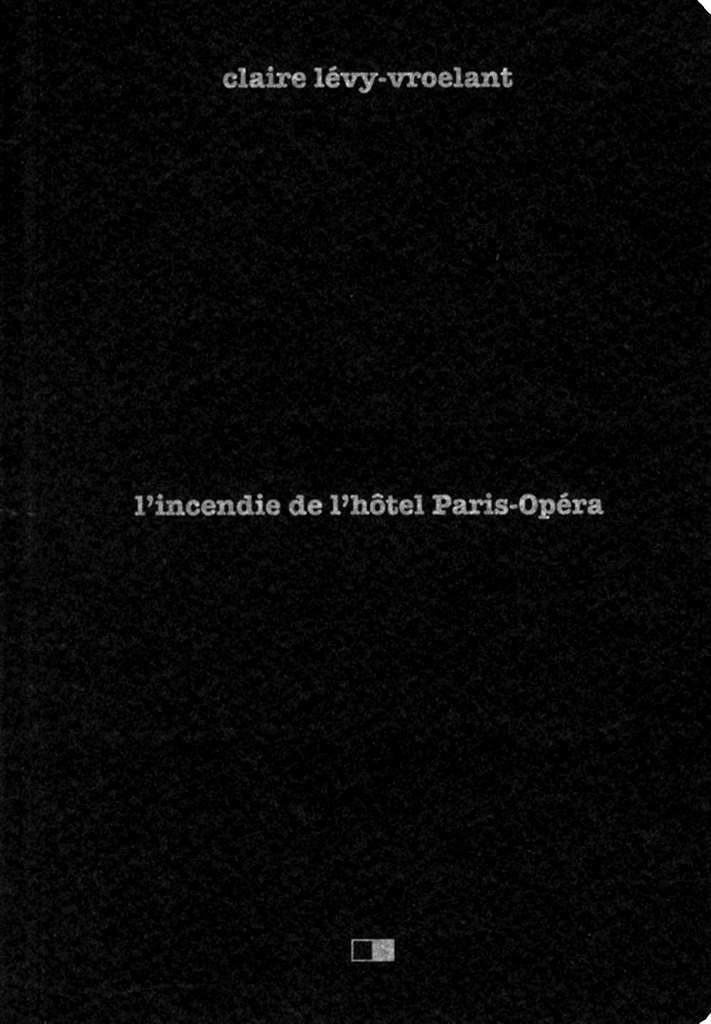 L’incendie de l’hôtel Paris-Opéra
L’incendie de l’hôtel Paris-Opéra
15 avril 2005
Enquête sur un drame social
Que valent des vies humaines ?
Dans la nuit du 14 au 15 avril 2005, un hôtel meublé brûlait à Paris près des Galeries Lafayette. Les familles, dont l’hébergement était pris en charge par le Samu social, étaient en situation de précarité, pour la plupart originaires d’Afrique. Vingt-quatre personnes, dont onze enfants, y laissent la vie. Il fallait ne pas laisser s’installer l’oubli.
Ce livre témoigne du désir partagé de rendre publique une expérience extrême et de donner lieu et sens à une mémoire de l’événement.
La sociologue Claire Lévy-Vroelant a enquêté sur ce drame social. Une quinzaine de personnes racontent, cheminant avec leurs mots pour exprimer l’indicible. Enregistrés et réécrits, leurs récits ont pris corps, dessinant des lignes de vie et de migration marquées par la violence d’un système.
Claire Lévy-Vroelant est sociologue de l’habitat et de la ville, professeure à l’université Paris 8, membre du Centre de recherche sur l’habitat de l’unité mixte de recherche LAVUE (CNRS).
Dans ses nombreuses publications, elle interroge la place faite aux nouveaux venus et aux étrangers dans la société urbaine et situe sa recherche dans le cadre plus large de l’histoire des migrations contem- poraines. Elle analyse ces faits sous l’angle des politiques de logement et des politiques sociales mais aussi sous celui des solidarités ordinaires, montrant le rôle des mémoires dans la fabrication plurielle de la ville. Elle a publié chez Créaphis deux livres importants liés à ces questions :
Hôtels meublés, Enquête sur une mémoire de l’immigration, avec la sociologue Céline Barrère (2012)
Une chambre en ville. Hôtels meublés et garnis à Paris, 1860-1990, avec l’historien Alain Faure (2007)

Une étude scientifique américaine, publiée dans la prestigieuse revue The Lancet Public Health vient de réévaluer à la hausse, et de façon spectaculaire, les effets de l’exposition au plomb sur la santé. Cet élément chimique, très présent dans notre environnement, peut être ingéré ou respiré. Il serait responsable d’une part plus importante que prévu de la mortalité aux États-Unis, notamment pour cause de maladies du cœur et des artères. Le chiffre avancé par les chercheurs est de 412 000 morts chaque année.
L’étude parue le 12 mars est fondée sur un suivi, de 1988 à 2011, de plus de 14 000 personnes constituant un échantillon représentatif de la population adulte américaine. L’exposition au plomb a été évaluée par leur plombémie.
Cette étude est méthodologiquement solide, du fait de la qualité des données collectées par les chercheurs et de la rigueur de leur exploitation. Elle comporte cependant certaines limites. Il existe en particulier la possibilité qu’un facteur non repéré soit la véritable cause des décès observés – une confusion ne pouvant être exclue formellement dans aucune étude épidémiologique. Les auteurs soulignent cependant que plus la plombémie augmente, plus la mortalité augmente, une constatation qui n’est pas en faveur d’une telle confusion.
En plus de la robustesse de l’étude, il existe des arguments à l’appui d’une relation de cause à effet, fondés sur des mécanismes plausibles de toxicité du plomb pour l’organisme. À titre d’exemple, on sait que le plomb favorise l’hypertension.
Ces différents éléments ont permis aux auteurs de livrer leurs conclusions sous la forme de proportion des décès attribuables à l’exposition au plomb. Elle est de 18 % pour la mortalité totale, soit 412 000 décès par an aux États-Unis. L’exposition au plomb serait en cause dans 29 % des cas de décès par maladies cardio-vasculaires, soit 256 000 décès par an.
Si ces chiffres sont impressionnants, ils ne sont qu’une demi-surprise pour les spécialistes. En effet, au fil des années, les chercheurs se sont intéressés aux doses de plomb de plus en plus faibles. Et ont mis en évidence des implications pour la santé d’une partie de plus en plus importante de la population.
Avant l’étude du Lancet Public Health, le seuil de toxicité connu pour ses effets cardio-vasculaires était relativement élevé (50µg/L ou microgramme par litre). Cette étude a mis en évidence les mêmes effets avec une plombémie plus faible (10µg/L). À noter que la toxicité de plus faibles plombémies était déjà établie pour le développement du cerveau et du système nerveux central de l’enfant.
Avec ce seuil abaissé, on inclut dans le calcul du risque attribuable au plomb une plus grande part de la population, au point que cette part représente désormais la majorité de la population.
L’étude américaine a impliqué des sujets âgés de 20 ans et plus, de 1988 à 1994 et suivis jusqu’en 2011. Il s’agit donc de personnes qui ont ou auraient eu cinquante ans et plus aujourd’hui. Leurs plombémies étaient plus importantes que celles constatées dans les générations suivantes car dans leur enfance, ces personnes ont respiré un air beaucoup plus concentré en plomb. En effet, les carburants automobiles en contenaient encore aux États-Unis jusqu’en 1975, année de leur interdiction. En France, la teneur autorisée en plomb dans l’essence a diminué à partir des années 1990. Puis ce métal lourd a été interdit en 2000. Pour autant, les plombémies observées chez les personnes nées après cette interdiction ne sont pas tombées à zéro, en raison des autres sources d’exposition, et le risque pour la santé n’a donc pas disparu.
1. Cet article a été rédigé à l’aide des informations et des analyses fournies pas le site The Conversation, qui est un média en ligne d’information et d’analyse de l’actualité indépendant, qui publie des articles grand public écrits par les chercheurs et les universitaires.
Lundi 19 mars 2018, la Cour suprême des États-Unis a donné le feu vert à deux recours collectifs (class actions)déposés par des résidents de Flint, Michigan en réponse à la crise de l’eau contaminée par le plomb.
Les habitants de l’ancienne ville industrielle, où plus de 100 000 personnes ont été potentiellement exposés à des niveaux élevés de plomb dans l’eau potable, poursuivent des revendications de droits civils contre les fonctionnaires de la ville et de l’État.
La haute cour a rejeté les arguments avancés contre les poursuites intentées par la ville de Flint, le comté de Genesee et responsables de l’environnement dans le Michigan.
La crise de l’eau de plomb contaminé Flint est l’un des pires scandales de santé au cours des dernières années aux États-Unis – provoquée par la décision des autorités de changer la source de l’approvisionnement en eau de la ville en 2014 pour réduire les coûts*. L’eau acide et polluée de la rivière locale avait été préférée à l’eau pure du lac Michigan. Elle a corrodé les tuyaux du réseau d’eau, exposant les résidents à l’empoisonnement au plomb.
Plus de 8000 enfants auraient consommé de l’eau contaminée au plomb, et une étude a révélé que la proportion des nourrissons et des enfants ayant des plombémies élevées a doublé après la modification de la source d’eau.
* Voir sur ce site, Flint – Du plomb dans les têtes
Une étude inédite sur la contamination au plomb a été conduite en Guyane de 2015 à 2017. Appelée « Guyaplomb », cette étude a été conduite sur près de 600 jeunes Guyanais de moins de 6 ans.
« On n’a pas retrouvé des cas extrêmes (…) mais pour les plombémies supérieures à 50 ou 100 µg/l, la Guyane présente une prévalence plus importante que celle retrouvée dans Saturn-Inf [enquête nationale en 2008] », a commenté Audrey Andrieu de la cellule interrégionale d’épidémiologique (CIRE). Cette étude montre que la « moyenne est de 22,8 μ/l », un taux plus élevé que celui mis en évidence en Guadeloupe (20,7), en Martinique (19,8) ou à l’échelle nationale. En France depuis 2015, le personnel médical doit signaler aux autorités toute plombémie supérieure à 50 μg/L.
Les premières détections de plomb remontaient à 2011 à Charvein, lieu-dit proche de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni (est). « Depuis Charvein, on avait peu de données sur le saturnisme à l’échelle guyanaise même si on suspectait une imprégnation élevée au-delà de cette zone géographique », a ajouté Mme Andrieu.
La CIRE a précisé que les causes de cette intoxication étendue « sont encore en cours d’étude », mais de fortes suspicions pèsent sur une cause alimentaire.
Les cas de saturnisme sont « plus importants chez les garçons et les enfants sous CMU » (couverture maladie universelle) et « sur le littoral guyanais ». Néanmoins, à Camopi et Trois-Sauts, villages amérindiens sur le fleuve Oyapock, frontalier avec le Brésil, les taux sont très élevés. A Camopi, 16 enfants sur 20 prélevés ont une plombémie supérieure à 50 µg/l.
Le saturnisme est particulièrement nocif chez les jeunes avec des effets neurologiques, rénaux et hématologiques.
Une autre étude épidémiologique a confirmé le maintien de la forte sur-imprégnation du mercure chez les autochtones du Haut Maroni, zone du Parc amazonien de Guyane, qui vivent à plusieurs heures de pirogue et d’avion du littoral.
Aujourd’hui, selon les responsables de l’étude, sur les 300 femmes enceintes et jeunes enfants suivis, « 87 % des femmes présentent un risque au niveau foetal » pouvant engendrer des « malformations définitives » et « 40 % des enfants » sont contaminés à plus de 5 µg/l.
La valeur seuil de l’Organisation mondiale de la santé est fixée à 10 µg/g de cheveu, mais pourrait être divisée par deux prochainement.
La sur-imprégnation dans le haut Maroni est démontrée depuis les années 90. Selon Rémy Pignoux, la baisse de 2012 à 2017 est néanmoins « significative » chez les femmes enceintes suivies, car elles « ont adopté les bons usages alimentaires », c’est-à-dire moins consommer les poissons du fleuve contaminés par le mercure utilisé pour l’orpaillage clandestin.
Sources : Mediapart, Ouest France.
La lettre d’informations de l’AFVS (n°15, décembre 2017) est parue. En voici l’éditorial.
Suppression des contrats aides et baisse des APL
Alors que le gouvernement ouvre une concertation concernant la mesure de la suppression des contrats aidés, la mobilisation s’amplifie pour préserver les emplois et l’action des associations. Le 10 novembre dernier, à l’appel du Collectif des associations citoyennes, d’un large front intersyndical, de collectifs unitaires locaux, voire avec le soutien de certaines mairies, les associations se sont mobilisées dans toute la France pour refuser le plan social sur les contrats aidés qui prévoit 250 000 suppressions d’ici fin 2018.
Face à la montée des protestations, le Premier ministre a annoncé le 9 novembre le lancement d’une concertation pour aboutir dès le mois de janvier à des propositions en matière de financement, d’engagement et d’accompagnement de la vie associative. Si le gouvernement a concédé de préserver les contrats aidés liés à l’urgence sociale, au handicap et aux quartiers prioritaires ainsi qu’une augmentation de 25 millions d’euros du Fonds pour le développement de la vie associative, il a refusé de revoir à la hausse l’enveloppe globale des crédits alloués, qui est passée de 2,4 milliards d’euros en 2017 à 1,4 milliard dans le projet de loi de finances de 2018, soit une diminution de 41,6 %, mettant au chômage 150 000 personnes en 18 mois, sans craindre d’augmenter la pauvreté, la misère et la souffrance sociale.
Face à cet état de choses, le Collectif des associations citoyennes appelle les associations à rester mobilisées et à s’exprimer conjointement avec les syndicats de salariés et les collectivités, les sénateurs à rétablir les crédits dédiés aux contrats aidés et les députés à voter en seconde lecture les crédits suffisants pour préserver les emplois associa- tifs comme préalable à une concertation digne de ce nom pour penser les alternatives aux contrats aidés.
Alors que pour réaliser des économies sur la dépense publique le plan logement du gouvernement Macron fait porter l’effort financier prioritairement sur le secteur social, force est de constater que c’est bien au modèle français de logement social auquel il s’attaque. Le gouvernement, sans aucune concertation, que ce soit avec les organismes HLM ou les associations de locataires, et sans faire réaliser les mesures d’impact sur le secteur du bâtiment, a décidé que les loyers HLM baisseraient de 5 euros (article 52 de la loi de finances) pour compenser la baisse de 5 euros de l’aide personnalisée au logement (APL) versée, qu’il a unilatéralement décidé par décret du 28 septembre 2017. Les HLM se retrouvent donc à devoir compenser 1,7 milliard d’euros sans y être préparés.
La volonté du gouvernement est donc de réduire la dépense publique associée au logement social tout en améliorant ses résultats : davantage de constructions, loyers moins élevés… Pourtant, le risque est grand que les organismes HLM, non préparés aux décisions du gouvernement, mettent en sourdine leurs projets de construction ou de travaux, le temps d’adapter leur fonctionnement et d’accéder aux fonds dont ils ont besoin, ce qui aura d’importantes conséquences non seulement sur le volet économique, mais également sur le volet social.
A l’initiative du DAL et de la Fondation Abbé Pierre, une large mobilisation associative et syndicale s’est mise en place, rejointe rapidement par le mouvement HLM et des collectivités locales. Le collectif Vive l’APL a été créé pour coordonner et élargir le mouvement en faveur d’un logement digne pour les familles les plus démunies. L’AFVS fait campagne au sein de ce collectif et a participé aux réunions et manifestations qui ont eu lieu à Paris. Une pétition a été largement signée (150 000 signatures) et remise à l’Élysée le jeudi 21 décembre par des responsables syndicaux et associatifs, dont l’AFVS.
La mobilisation est à suivre sur https://vivelapl.org/
Pour télécharger la lettre d’information, cliquer ici
La prochaine réunion des familles aura lieu le dimanche 11 février 2018, au siège de l’association.
Comme d’habitude, cette réunion vise à faciliter les échanges sur les questions qui nous concernent le plus directement (le plomb, le saturnisme, le logement, etc…). Ces rendez-vous bimestriels sont également l’occasion de prises de contacts, de discussions et de rencontres.
Le thème principal de la rencontre sera consacré aux questions du logement, et notamment de la sur-occupation des habitations.